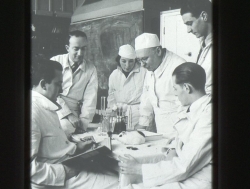sa vie
Retour au catalogue
Arnault TZANCK
ARNAULT TZANCK
Le Fondateur de la transfusion française
Par Jean-Jacques LEFRERE
Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL
DE LA TRANSFUDION SANGUINE (INTS)
Bien qu'il soit inscrit sur quelques plaques commémoratives et sur celle d'une place du XVIIe arrondissement de Paris, le nom d'Arnault Tzanck, à la consonance difficile, est aujourd'hui à peu près inconnu du grand public. Celui qui le portait a cependant été le pionnier, en France, d'une grande cause médicale et humanitaire : la transfusion sanguine.
Né le 18 avril 1886 à Vladikavkaz — Vladicause dans sa forme francisée —, capitale de l'Ossétie du Nord, Arnault Tzanck appartient à une famille juive fortunée. Peu après sa venue au monde, s'amplifie la persécution des Juifs de cette région, qui se voient interdits de posséder des terres. Le père de Tzanck liquide en hâte les siennes, pourtant récemment acquises, vend tous ses biens et, pour fuir la vague de pogroms qu'il pressent prochaine, décide de quitter à jamais le Caucase. La famille, qui comprend cinq enfants — Arnault est le cadet —, s'embarque en 1887 à Batoum à destination de la France. Transplantation réussie : les parents ouvrent une fabrique de kéfir, boisson gazeuse du Caucase issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. Sans connaître le triomphe du chocolat, du café ou du coca-cola en d'autres temps, l'entreprise réussit et redonne la prospérité à la famille. Le produit se vend bien : même les hôpitaux parisiens se fournissent en kéfir.
Le jeune Arnault fait ses études secondaires à Paris, au lycée Montaigne, puis s'inscrit en Faculté de médecine. Il est nommé externe en 1904. De 1910 à 1914, il est interne à l'Hôpital Saint-Louis, où il se spécialise en dermatologie, spécialité alors peu courue, la plupart des maladies de peau étant considérées à l'époque comme d'origine infectieuse, et les dermatologues comme de simples observateurs de l'écorce et de l'apparence. Même si, par la suite, son attention va s'en détourner en partie au profit de la transfusion, Tzanck poursuivra sa carrière en dermatologie, mais surtout comme chercheur.
Au cours de ces années d'avant-guerre qui le voient interne à Saint-Louis, Tzanck se plaît à fréquenter un milieu d'artistes, de musiciens et d'écrivains, dont certains sont des déracinés comme lui. Il fait notamment la connaissance de Guillaume Apollinaire et d'Henri-Pierre Roché, l'auteur de Jules et Jim. Il appartient au cercle d'amis qui gravite autour de Marie Laurencin, avec laquelle le jeune Tzanck a une brève liaison, après la rupture avec le poète d'Alcools. Le médecin et l'artiste se perdront de vue pendant des années, avant de renouer après la Deuxième Guerre mondiale. Daniel Tzanck, le frère aîné (1874-1964), est dentiste et fréquente encore davantage les représentants de l'avant-garde, qui sont à la fois ses amis et ses patients. Comme il collectionne tableaux et livres, il leur laisse la possibilité de régler ses honoraires en nature, sous forme d'œuvres d'art ou de beaux ouvrages (Marcel Duchamp lui remet ainsi un trompe-l'œil intitulé Chèque Tzanck, qui fera entrer plus tard le nom du bénéficiaire dans l'Histoire de l'Art).
La Première Guerre mondiale éclate alors qu'Arnault Tzanck passe sa thèse de médecine. En 1915, marié et récemment père d'un fils, il est envoyé au Front, comme la plupart des internes des hôpitaux, et affecté à l'ambulance chirurgicale que dirige le chirurgien Antonin Gosset. Cette expérience, outre qu'elle va lui permettre d'obtenir la nationalité française — accordée à tout étranger se battant pour la France —, va changer radicalement ses projets de futur démobilisé. Les scènes auxquelles il assiste dans les salles d'opération proches des lieux de combat vont le marquer durablement : comment pouvait-il en être autrement pour cette génération de médecins confrontée aux massacres de la Grande Guerre ? Le Journal que Tzanck tient pendant le conflit narre la vie quotidienne d'un praticien recevant chaque jour les soldats tombés lors des attaques : « Ça a été du carnage. Dans les yeux des blessés, on retrouve pour ainsi dire empreintes les heures d'épouvante qu'ils ont vécues là-bas » (2 octobre 1915).
Dans le sentiment général d'impuissance face au déluge de chocs hémorragiques mortels, Tzanck prend conscience de la désastreuse indisponibilité des transfusions de ce sang qui pourrait sauver tant de combattants. Car, face à ce problème, médecins et chirurgiens sont désarmés : les hommes qu'on leur amène sans cesse sont souvent saignés à blanc, et certains ne parviennent même pas à l'ambulance ou à l'hôpital : exsangues et froids, exposés pendant des heures aux intempéries, ils ont déjà succombé à l'hémorragie. Ni l'organisation ni le savoir-faire de la transfusion n'existent au début du conflit, et le monde médical observe même, à l'égard de cette pratique, une réserve pleine de prudence.
Cependant, avec les premiers engagements, apparaît la nécessité pressante de redonner du sang à ceux qui le versent pour leur patrie. Le 16 octobre 1914, à l'Hôpital de Biarritz, a lieu la toute première transfusion sanguine de la guerre : Isidore Colas, un Breton en convalescence à la suite d'une blessure à la jambe, sauve, par le don de son sang, Henri Legrain, caporal au 45ème d'Infanterie, apporté du Front en état de choc hémorragique. La détermination du groupe ABO n'est pas encore entrée dans la pratique, loin de là, mais leurs sangs doivent être compatibles, car l'intervention réussit. À la fin de la même année, quarante-quatre transfusions sont ainsi pratiquées en France, toujours dans la méconnaissance complète du danger lié aux différences de groupes sanguins. Les donneurs sont des éclopés guéris ou des membres du personnel infirmier des hôpitaux de campagne.
Au cours des années suivantes, et jusqu'à la fin des hostilités, la transfusion de sang aux grands blessés se développe dans les ambulances militaires, tout en demeurant timidement, parcimonieusement, appliquée. Les donneurs sont, selon les cas, des camarades de combat, des parents venus en hâte, des infirmiers. Le corps médical est frappé par ces retours à la vie générés par la transfusion chez ces grands blessés paraissant condamnés, autant de sauvetages qui semblent tenir du miracle. Pourtant, réaliser un acte transfusionnel n'est pas aisé, surtout dans une ambulance militaire débordant de soldats meurtris et d'agonisants. C'est que l'on ne dispose pas encore de méthode pour empêcher le sang de coaguler, lorsqu'on le recueille chez les donneurs : il faut transfuser de « bras à bras », selon une méthode mise au point par George Crile, un chirurgien de Cleveland. Pour cette transfusion « directe », l'artère radiale du donneur est reliée chirurgicalement à une veine du receveur, allongé à son côté, soit par une canule, soit par une suture qui entraîne, pour le donneur, la perte définitive de son artère. Les premières transfusions sont ainsi entièrement dépendantes d'un acte chirurgical. Heureusement, début 1917, Emmanuel Hédon (1863-1933), professeur de physiologie de la Faculté de Montpellier, entreprend, dans les vieux bâtiments de la clinique Saint-Charles, d'étudier l'effet du citrate de soude pour prévenir artificiellement la coagulation du sang prélevé chez un sujet. En mai de la même année, Émile Jeanbrau (1873-1950), professeur de chirurgie urologique dans la même ville, mobilisé sur le Front mais ayant suivi les travaux de son collègue Hédon, pratique, sur des blessés de l'Ambulance n° 13, les trois premières transfusions faites avec un sang ainsi anticoagulé, que l'on va désormais appeler le « sang conservé » ou « sang stabilisé ». La pratique transfusionnelle s'en trouve immédiatement facilitée : de « directe », la transfusion peut devenir « indirecte », sans continuité entre les vaisseaux du donneur et du receveur, sans même que le premier soit présent au moment où l'on transfuse le second.
Ainsi, même si la technique de transfusion directe artério-veineuse est apparue trop complexe et trop délicate à réaliser dans des ambulances militaires sans cesse envahies de blessés graves, et dans des conditions de travail souvent épouvantables — elle ne pouvait guère s'effectuer qu'en arrière du champ de bataille, dans une structure sanitaire adaptée —, la Première Guerre mondiale aura été, en fin de compte, un puissant aiguillon du développement de la transfusion, en même temps qu'un immense et dramatique terrain d'expérimentations. La science — les découvertes récentes du groupe sanguin ABO et des effets du citrate — et la pratique se sont rejointes à la fin des hostilités, pour jeter les bases de la transfusion moderne. Tzanck admettra par la suite que jamais une période de paix n'aurait poussé de la sorte les médecins à l'acte. Pendant son travail à l'ambulance de Gosset, il a eu vent des résultats de Jeanbrau, qui l'ont vivement intéressé, quoiqu'il se montrera longtemps plus favorable au sang transfusé pur qu'au sang anticoagulé par du citrate.
Démobilisé — et décoré de la Croix de guerre —, Tzanck rejoint l'Hôpital Saint-Louis pour y poursuivre sa formation en dermatologie, mais il compte désormais consacrer une partie de son temps à la transfusion et à sa discipline-sœur, l'hématologie. Car la demande est devenue réelle : revenus du Front, les chirurgiens entendent bien continuer à appliquer les techniques transfusionnelles mises au point à proximité des tranchées. Ils ont compris que seule la transfusion peut sauver des malades risquant de succomber à une forte hémorragie, quelle qu'en soit la cause. Clairement, la transfusion est désormais considérée comme l'acte thérapeutique essentiel pour lutter contre le choc lié à une perte de sang gravissime. Curieusement, ce n'était pas réellement le cas auparavant. Tzanck a une autre raison, plus personnelle, de contribuer au développement de la transfusion : il a perdu une sœur des suites d'une hémorragie obstétricale et une transfusion aurait pu la sauver.
Certes, Tzanck continuera, toute sa vie, à s'intéresser à la dermatologie, sa première spécialité, mais sa mobilisation, en 1915, a donné une seconde orientation à sa carrière professionnelle, et les horreurs de la Première Guerre mondiale vont transformer le dermatologue un tantinet mondain en apôtre de la transfusion. En 1923, il a déjà organisé, dans un bâtiment de l'Hôpital Saint-Antoine, à Paris, un véritable « centre de transfusion », qui est le premier au monde à voir le jour. Les conditions de travail y sont toutefois des plus modestes : l'administration de l'hôpital a mis à sa disposition une petite pièce, cloisonnée de planches et aménagée dans la salle des admissions. Ce réduit de deux mètres et demi sur trois a, pour tout ameublement, une table, une chaise et un téléphone.
Tel est l'ancêtre de tous les établissements de transfusion d'aujourd'hui. La secrétaire qui en assure la permanence dispose d'un fichier des donneurs que l'on peut contacter. Car Tzanck estime que, pour être pleinement efficace, la transfusion doit disposer à tout moment de donneurs de sang. Dans les premiers temps, il s'est adressé aux familles et aux proches des malades et des blessés de l'hôpital — une pratique encore généralisée aujourd'hui dans nombre de pays en voie de développement. Puis, avec son entrain naturel, sa chaleur et sa force de conviction, il est parvenu à recruter des volontaires, non seulement parmi le personnel médical — infirmières et étudiants —, mais aussi dans différents corps de métier. Ayant obtenu l'autorisation du préfet de police de Paris, il prononce régulièrement des conférences devant les gardiens de la paix pour les convaincre de devenir donneurs : un contingent nombreux est ainsi constitué, et qui ira s'amplifiant. À leur tour, les sapeurs-pompiers parisiens sont sollicités pour venir offrir leur sang au poste d'urgence de Saint-Antoine : ils ont l'avantage d'être toujours joignables et prêts à répondre à l'appel, ce qui n'est pas toujours le cas des autres donneurs. Parfois, les médecins de garde retroussent eux-mêmes la manche pour donner leur propre sang. Tzanck, de son côté, donnera plus de deux cents fois au cours de sa vie, même après l'âge limite, qu'il a lui-même, dès le début, fixé à 60 ans.
Dans les premiers temps, la Direction de l'Assistance publique a considéré l'aventure avec un scepticisme à peine dissimulé, d'autant que le local de Saint-Antoine ne ressemble guère à un centre médical classique. On y croise d'élégantes visiteuses à chapeau, grandes dames de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie ayant répondu à l'appel de Tzanck et apportant une main d'œuvre bénévole et surtout un soutien financier, car il faut rétribuer les donneurs : un franc par centimètre cube est le tarif habituel. Par la suite, l'Assistance publique de Paris prendra en charge une partie, puis la totalité de ces indemnités versées pour les transfusions réalisées dans ses hôpitaux.
Les résultats obtenus par cette petite organisation se révèlent immédiatement spectaculaires : dès l'année 1924, le nombre d'accouchées mortes d'hémorragie à la maternité de Saint-Antoine diminue de manière radicale. À vrai dire, on n'en observe plus aucune.
En 1928, Tzanck, qui va bientôt être nommé « médecin des Hôpitaux de Paris » — il était temps : il a 42 ans — fonde une association qu'il baptise Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence. Gosset, son supérieur de l'ambulance militaire, et l'obstétricien de la Maternité de Saint-Antoine, Edmond Levy-Solal, l'ont aidé activement dans cette entreprise. Louis Mourier, directeur général de l'Assistance publique de Paris, fait également partie du comité. De grandes dames de l'aristocratie — la duchesse d'Uzès (présidente du comité d'honneur), la marquise de Crussol, la vicomtesse de Fontenay, la baronne Robert de Rothschild — ont apporté leurs deniers et la puissance de leurs relations. La structure va par la suite bénéficier grandement du dynamisme de ces dames, qui rivalisent d'imagination et d'initiatives pour collecter les fonds nécessaires lors de galas et de tombolas.
Le but de cette Œuvre est de répondre à la sollicitation des prescripteurs hospitaliers de transfusions. Car, de plus en plus, le poste de Saint-Antoine, qui tient lieu à la fois de permanence, de secrétariat et de laboratoire, se trouve sollicité pour les urgences transfusionnelles de tous les hôpitaux de Paris. Une des actions prioritaires est donc de constituer un réseau de donneurs mobilisables à chaque urgence, par des « astreintes à domicile » à jour fixe. Tous sont des « donneurs universels », appartenant au groupe O. La grande innovation de la transfusion devenue civile a été en effet de prendre en compte la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Quelques années plus tard, Tzanck évoquera dans un livre l'historique de cette Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence et ses premières conditions de fonctionnement : « Cette organisation ne pouvait s'inspirer des réalisations étrangères : en Europe, rien de comparable n'avait été fait ; en Amérique, les organisations comparables étaient à peine ébauchées ; et en tout cas ne visaient pas particulièrement la clientèle hospitalière. Au surplus, ces organisations étaient alors inconnues en France. Il fallait trouver une formule particulière qui permit d'indemniser les donneurs de leurs frais de déplacement, de leur temps perdu, et même de la fatigue causée, mais sans prétendre donner le « prix du sang ». On conservait ainsi au geste du donneur son caractère généreux. »
L'activité du centre de Saint-Antoine s'accroît dès lors de manière vertigineuse : plus de deux cents transfusions réalisées en 1929, près de huit cents l'année suivante, deux mille en 1931, près de quatre mille en 1932, huit mille l'année d'après. Ce chiffre passe à trente-cinq mille dans l'ensemble des hôpitaux parisiens pour la période 1933-1939. L'Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence est reconnue d'utilité publique le 14 janvier 1931, par un décret signé Gaston Doumergue.
Ces premières années ont leur côté héroïque : un petit groupe de médecins « qualifiés » a accepté d'être contacté par téléphone et de se rendre en urgence sur l'hôpital d'où a été lancé l'appel. Pendant ce temps, la secrétaire appelle un des donneurs du fichier : une voiture va le chercher à domicile pour le conduire en présence du malade, dans un hôpital ou en ville. Parfois, le malade a eu malheureusement le temps de mourir avant l'arrivée de l'équipe de transfusion. Ceci, bien sûr, au cours des premiers temps de fonctionnement, pendant lesquels Tzanck pratique encore la transfusion de bras à bras. Il ne fait plus appel à un chirurgien, mais transfuse ses patients avec un appareil de sa conception et de sa fabrication ¬¬— l'homme a de l'habileté manuelle et se plaît à dessiner des plans d'instruments de son invention. Son appareillage consiste en une seringue montée sur un distributeur à trois voies, avec des pompes manœuvrées par un robinet, mais assez difficiles à manier : il suffit d'un peu de lenteur dans l'opération pour que le sang prélevé coagule. Cependant, ce système ne fait pas courir le risque, comme un autre appareil concurrent contemporain, de passage du sang du receveur dans le système vasculaire du donneur (le contraire de l'effet voulu !). De plus, un ballon permet de mesurer, quoique approximativement, le volume de sang transfusé, et ceci est une innovation totale. Tzanck fait régulièrement la démonstration de son appareil aux apprentis transfuseurs : il ponctionne la veine du receveur, se fait piquer sa propre veine par un des assistants, monte l'appareil et exécute l'opération avec son unique main libre.
Tzanck pressent tellement les complexités de la thérapeutique qu'il est en train de faire germer qu'il impose des précautions demeurant de mise aujourd'hui dans la sélection des candidats au don de sang : les sujets qui se présentent doivent remplir une déclaration sur l'honneur portant sur leur état de santé et sont examinés dans un local dépendant de la consultation de médecine de Saint-Antoine. Tzanck écarte en outre les sujets tuberculeux et impaludés. Ce n'est pas tout : une prise de sang, en vue du dépistage de la syphilis, est systématiquement envoyée dans le service de l'Hôpital Broca où Tzanck a été nommé, en 1932, responsable de la consultation de dermatologie (il ne rejoindra Saint-Louis, l'hôpital de sa formation, qu'en 1937, pour y prendre la tête d'un des six services de dermatologie de cet hôpital).
Le règlement, établi par Tzanck lui-même, pour être donneur en France dans les années 1930, apparaît aujourd'hui comme une sorte de charte pionnière du don de sang. Même si certains éléments en sont devenus obsolètes avec les années, les conditions physiques et morales préconisées restent de mise :
« Pour être donneur de sang, il faut :
- Être bien portant.
- Pouvoir être atteint par téléphone.
- Soit pouvoir se rendre une fois par mois à un appel de transfusion d'urgence, soit accepter de prendre la garde une fois par mois à la Permanence de l'Œuvre, à l'Hôpital Saint-Antoine, le matin de 9 h. à 13 h. ou l'après-midi de 13 h. à 19 h.
- S'engager à se rendre à tout appel dans le moindre délai. […]
Le fait de donner son sang constitue avant tout un acte de dévouement. Pour qu'il soit complet, le Donneur doit :
- Être sobre et de santé parfaite ; s'il s'aperçoit sur lui-même de la moindre lésion, c'est un devoir moral pour lui de mettre au courant immédiatement les médecins attachés à la Transfusion Sanguine d'Urgence. […]
- En raison de l'impressionnabilité des malades, l'apparence personnelle du Donneur est très importante. Il doit donc être propre sur sa personne et correct dans sa tenue, quand il répond à un appel. »
Qui douterait encore de la nécessité d'une organisation bien structurée pour la transfusion d'urgence ? Un événement national va convaincre les derniers sceptiques. Le 6 mai 1932, Paul Doumer, président de la République, vient d'arriver à la Fondation Salomon de Rothschild, rue Berryer, près de la place de l'Étoile, où se tient la vente de bienfaisance annuelle en faveur des écrivains anciens combattants et en mémoire de ceux tués à la guerre. Doumer se trouve devant le stand de Claude Farrère, président de l'association organisatrice (et prix Goncourt 1905 pour Les Civilisés), lorsqu'un émigré russe du nom de Paul Gorguloff — un docteur en médecine ! — tire dans sa direction trois coups de revolver qui le blessent grièvement, à la tête et sous le bras. Le corpulent Farrère, qui tente de s'interposer, est lui-même atteint de deux balles dans le bras. Le Président est évacué vers l'hôpital Beaujon. L'artère humérale tranchée, il perd beaucoup de sang : il lui faut une transfusion de toute urgence. Tzanck, qui est pratiquement le seul spécialiste de transfusion dans le Paris de l'époque, est appelé en catastrophe. Se faisant accompagner par sa domestique, laquelle, par son groupe ABO, est donneuse universelle, il se précipite dans sa voiture, garée au pied de son domicile de la rue Goujon. Au passage, il embarque un agent qui saute sur le marchepied et, se cramponnant à la portière, ouvre la circulation à coups de sifflet. Le médecin arrive trop tard : malgré plusieurs transfusions, le Chef de l'État meurt au cours de la nuit. Le hasard, qui a ses cruautés, a voulu que l'Union des soins à domicile Arnault Tzanck de Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, ait pour adresse l'avenue... Paul-Doumer.
Autre intervention spectaculaire : le soir du 23 décembre 1933, un monstrueux accident de chemin de fer survient à Lagny-Pomponne : le rapide Paris-Strasbourg percute par l'arrière l'express Paris-Nancy. L'accident, qui fait deux cents morts et des centaines de blessés, devient la seconde catastrophe ferroviaire la plus meurtrière en France. Les transfuseurs du Centre d'urgence de Saint-Antoine accourent sur les lieux, et le sang des donneurs mobilisés sauve quelques vies.
Les besoins en sang continuent à aller croissant, à une époque où les actes chirurgicaux se développent considérablement. Or le don de sang ne correspond pas encore à une démarche spontanée : il n'est que la réponse à une sollicitation, avec, de surcroît, une rétribution à la clé. Tzanck, pourtant, a toujours prôné le bénévolat et, avec les années, seuls toucheront une indemnité les « donneurs de garde », qui doivent répondre à tout appel urgent lancé, de jour comme de nuit, par les hôpitaux parisiens.
Dans plusieurs pays, diverses pistes sont explorées par des pionniers de la transfusion. La plus déroutante est celle pratiquée, au début des années 30, par le Russe Serge Judine. Ce médecin (dont la ressemblance avec Louis Jouvet tient du prodige) dirige, dans l'Institut Silfassyvski de Moscou, un service de chirurgie d'urgence dont les besoins transfusionnels sont très importants. Depuis quelque temps, il fait appel à des donneurs bénévoles — mais non volontaires — en prélevant du sang de cadavre : à coups de massages cardiaques, il saigne les individus tués par accident ou morts subitement. L'efficacité de ces transfusions se révèle comparable à celle du sang de donneur vivant, mais, comme la loi russe, correspondant au décret français du 15 mars 1928, empêche de toucher à un cadavre dans les vingt-quatre heures qui suivent le décès, Judine agit clandestinement. La pratique finit toutefois par s'éventer et, après une polémique ardue, est officiellement interdite. Le Congrès international de transfusion qui se tient à Paris en 1937 condamne aussi le procédé, repoussant même tout projet de prélever du sang de cadavre frais, fût-ce à visée d'étude.
Renonçant peu à peu à la transfusion de bras à bras, Tzanck finit par admettre les avantages du « sang conservé ». Ce sang, stabilisé pour quelques jours, peut être transporté pour une utilisation à distance et différée dans le temps. Il peut en outre être, avant son emploi, l'objet de contrôles biologiques et être injecté au rythme désiré, par des perfusions lentes ou au contraire rapides, et en quantité connue, ce qui n'était pas le cas du sang passé de bras à bras, pour lequel on arrêtait souvent la transfusion lorsque le donneur devenait plus pâle que le receveur ! Une première « banque de sang » s'est ouverte à Chicago en 1937 : on y conserve, à basse température, du sang citraté conservable pendant deux semaines. Tzanck adopte définitivement cette pratique l'année suivante — la transfusion militaire fait de même — et s'équipe en bouteilles de verre et en citrate.
Ces techniques de conservation du sang connaissent d'ailleurs un regain d'intérêt en vue de l'éventualité d'une nouvelle guerre. La possibilité de constituer des stocks a vu sa première utilisation massive en 1936, au centre de Barcelone, pour la prise en charge des blessés de la guerre civile : une rivière de près de 9000 litres de sang a été transfusée pendant la durée de ce conflit, qui en a d'ailleurs fait couler un véritable fleuve. Parmi les médecins français ayant apporté leur soutien aux combattants républicains espagnols, a figuré le nom d'Arnault Tzanck, membre du comité de la Centrale sanitaire d'aide à l'Espagne républicaine : de nombreux dons de sang prélevés et préparés à Saint-Antoine ont été expédiés pour soutenir la « Cause ».
Deux ans plus tard, devant la perspective d'un nouveau conflit mondial, la pratique de conservation du sang à basse température, dans des ampoules citratées, va s'amplifiant. Des mallettes isothermes sont mises au point pour le transport sur le terrain des combats par des formations sanitaires. Tzanck propose au ministère de la Guerre que les groupes sanguins des appelés soient établis de manière systématique et inscrits sur leur plaque d'identité. Une suggestion aussi simple que pleine de bon sens, mais qui suscite une polémique… laquelle ne sera pas épuisée lorsque la Seconde Guerre mondiale sera déclarée.
Tzanck n'a jamais manqué de charisme. Sans cet atout, il ne serait sans doute pas parvenu à doter sa patrie d'adoption d'une organisation transfusionnelle qui va servir de modèle à de nombreux pays. Il a été aussi un propagandiste très efficace. En marge de son activité médicale proprement dite, il prononce des conférences dans les salles populaires ou dans les salons du Faubourg Saint-Germain : dans les premières, pour recruter des donneurs, car il sait aussi transfuser l'altruisme ; dans les seconds, pour en appeler à la générosité de quelques mécènes. Avec les fonds recueillis, il peut ainsi faire construire en 1937, dans l'enceinte de l'Hôpital Saint-Antoine, un bâtiment suffisamment spacieux pour les besoins de développement de son centre. En réalité, le financement a été principalement assuré par Mme Raba Deutsch de la Meurthe, membre d'une famille à la fortune immense, connue pour son action caritative dans les domaines de la technologie et de la philanthropie. L'Assistance publique a donné son accord et fourni le terrain.
Tzanck devient tout naturellement le directeur de ce Centre de Transfusion sanguine et de recherches hématologiques. Pendant les premiers mois d'activité, les locaux en sont jugés beaucoup trop vastes par ceux-là mêmes qui y travaillent, mais leur point de vue changera du tout au tout en 1939, au début des hostilités, lorsqu'il faudra même compléter les installations par des cantonnements construits par le Génie : des laboratoires et des services de collectes de sang supplémentaires seront aménagés en hâte dans des baraques de bois au toit goudronné. Pour l'heure, le bâtiment tout neuf — et encore debout aujourd'hui, quoiqu'un peu décati — est inauguré en juin 1938 par Marc Rucart, ministre de la Santé. La presse se fait l'écho de l'événement, non sans le placer dans la perspective d'un conflit franco-allemand dont l'échéance paraît inévitable et proche : « Le pavillon, rationnellement construit et aménagé d'une façon des plus modernes, comprend des laboratoires destinés aux examens et recherches hématologiques et abrite les services de l'œuvre de la transfusion sanguine urgente qui assure chaque année, en étroite collaboration avec l'administration de l'Assistance publique plus de 5000 transfusions dans les hôpitaux parisiens. […] Les nouveaux locaux composent une innovation : une chambre froide pour le stockage en ampoules du sang humain prélevé sur des donneurs bénévoles qui pourra être utilisé pendant une période de trois semaines. […] Rappelons qu'un deuxième centre, établi à plusieurs mètres sous terre, sera créé à quelques kilomètres de Paris. »
La dernière phrase ne relève pas entièrement des fantasmes qu'engendre toute guerre. Mobilisé en septembre 1939 dans sa spécialité, avec le grade de lieutenant-colonel, Tzanck se voit chargé d'organiser à Blois un centre de transfusion destiné à prendre le relais, si nécessaire, du centre de Paris. Il devient aussi un acteur de premier plan dans l'organisation de la transfusion militaire et, soutenu par le ministère de la Santé et le Service de Santé de l'Armée, il établit un réseau national avec tous les centres de province. Car, dans ces années d'immédiate avant-guerre, la structure mise en place par Tzanck à l'Hôpital Saint-Antoine a été reprise dans la plupart des grandes villes de province, et des centres régionaux de transfusion sont entrés en fonction.
En ces heures au ciel plombé, il importe en premier lieu de constituer des réserves en sang. Le 14 septembre 1939, Le Figaro publie un article intitulé Six cents personnes viennent chaque jour à l'Hôpital Saint-Antoine offrir leur sang pour la France : « Dès la guerre déclarée, le sang a afflué à ce petit pavillon en briques rouges, comme s'il eut été le cœur de la France. Hier, dans les trois heures où le Centre sanguin reçoit sa clientèle du dévouement, on a compté six cent dix donneurs. C'est à peu près la moyenne quotidienne. Beaucoup d'étrangers parmi ces volontaires : des Russes, des Tchèques. On y a même vu un Allemand. Il venait offrir une pinte de sang avant de gagner son camp de rassemblement. Beaucoup de donneurs se voient récusés. On n'accepte que des sujets parfaitement sains et seulement ceux qui ont un sang « universel », c'est-à-dire pouvant être infusé à tout le monde. » De même, soixante-deux ans plus tard, l'on verra affluer, dans les Centres de transfusion du monde entier, des foules traumatisées par le spectacle d'avions s'écrasant sur les Twin Towers de New York.
Après la Drôle de guerre, la défaite et l'armistice, Tzanck regagne son service de dermatologie de l'Hôpital Saint-Louis. Mais à partir de l'été de 1940, la presse antisémite, notamment le journal Le Pilori, s'en prend aux médecins juifs, appelant à leur boycottage et publiant leur nom et leur adresse. Tzanck, personnalité médicale très connue, fait l'objet d'une campagne particulièrement haineuse. Une première étape de l'exclusion des médecins juifs est la loi du 16 août 1940, interdisant l'exercice de leur métier aux praticiens étrangers, à ceux qui n'ont acquis la nationalité française qu'après 1927 et à ceux qui sont nés en France de père étranger. Une fois l'arrêté promulgué, les praticiens étrangers ont huit jours pour cesser leur activité, sous peine de s'exposer à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Le 3 octobre suivant, une nouvelle loi stipule qu'il est désormais interdit aux Juifs d'être professeur de Faculté, chef de clinique ou assistant. L'Assistance publique de Paris applique cette législation visant à l'« aryanisation ». Dans l'amertume que l'on conçoit, Tzanck, menacé d'arrestation, passe en zone libre avec les siens ; il séjourne à Lodève, dans le Languedoc, et à Marseille. Puis, pour échapper à l'arrestation et à la déportation, il passe clandestinement les Pyrénées, perdant au passage tous ses bagages et son passeport. En Espagne, sa notoriété joue en sa faveur : des médecins le cachent et lui procurent un visa pour se réfugier au Chili. Après avoir fui son pays natal dans l'enfance, le voilà contraint, pour les mêmes raisons, de fuir sa terre d'adoption.
Dans son exil chilien, l'homme d'action se souvient qu'il est aussi homme de réflexion et, pour occuper cet intolérable inactivité que lui impose l'occupation allemande de son pays, il compose un ouvrage, méditation philosophique et éthique sur la connaissance, sur les pièges de la raison, sur les problématiques de la biologie. Bien que l'influence de Bergson et de Claude Bernard y soient sensibles, l'auteur y fait montre d'un esprit libre de tout conformisme. Tzanck en achève la rédaction à Santiago-du-Chili en avril 1943. Sous le titre La Conscience créatrice. Entretiens sur la vie et la pensée, le texte est publié l'année suivante à Alger, chez Charlot, un libraire-éditeur qui vient de faire paraître les premiers livres d'un certain Albert Camus.
Car, courant 1944, Tzanck a rejoint Alger pour s'y s'associer à l'action engagée, dès le débarquement allié en Afrique du Nord, par son confrère Edmond Benhamou, de l'Hôpital Mustapha, lequel organise le ravitaillement en sang des Forces françaises évoluant dans la région, puis celui des organismes de réanimation du front de l'Ouest et de la première Armée Française en Alsace. Deux fortes personnalités, Benhamou et Tzanck, et des relations que ternissent quelques nuages.
Le développement de la transfusion illustre remarquablement l'influence des conflits internationaux sur le progrès scientifique en général, et médical en particulier. Durant la Première Guerre mondiale, l'hémorragie sur le champ de bataille a éperonné la pratique de la transfusion, qui s'est poursuivie, harmonisée et organisée après le conflit. Les progrès de la transfusion ont subi un brutal coup d'arrêt dès les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale et pendant l'Occupation, pour reprendre de plus belle, à partir de novembre 1942, lors du débarquement des troupes anglo-saxonnes en Afrique du Nord. La recherche en temps de paix n'en reste pas moins à prôner.
Dès la Libération de Paris, se met en place une organisation, à la fois civile et militaire, de la transfusion, placée, jusqu'en juin 1945, sous la direction de Tzanck — qui attendra cependant d'être versé dans la réserve pour lancer cette boutade : « J'ai souvent vu militariser des civils, j'ai rarement vu civiliser des militaires. » Puis, après avoir participé, en uniforme de colonel des Forces françaises libres, à l'accueil des survivants de la déportation à l'Hôtel Lutetia, Tzanck reprend, à l'Hôpital Saint-Louis, le service qu'il a été obligé de quitter pendant l'Occupation. Comme avant-guerre, il continue à mener de front sa double activité : dermatologue à Saint-Louis et transfuseur à Saint-Antoine.
Dans les années d'immédiate après-guerre, la transfusion française va cahin-caha. De grandes quantités de sang restent nécessaires, la réanimation et la chirurgie devenant de plus en plus exigeantes et consommatrices. C'est l'époque où les donneurs deviennent uniquement bénévoles et volontaires, prenant le relais de ces donneurs rémunérés que l'on appelait jadis en urgence. Ainsi naît, en 1949, la première Fédération nationale de donneurs bénévoles, dont Tzanck, qui en a été l'âme et le muscle, reçoit la présidence d'honneur. Il sera aussi l'un des inspirateurs de la loi du 21 juillet 1952, qui va réglementer les principes éthiques du don de sang, selon lesquels « le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce, comme issu du corps humain ».
Dès lors, dans toute la France, souvent à partir d'initiatives individuelles, apparaissent de nombreux centres de collecte du sang, où les donneurs sont conviés et accueillis régulièrement. La plupart du temps, cette collecte s'est structurée à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un hôpital. En mars 1949, un épisode, auquel Tzanck, décidément pionnier en tout ce qui touche à la transfusion, est encore associé, va profondément changer, ou plutôt élargir, les méthodes de collecte. Dans une petite usine de Vincennes, trois ouvriers gravement blessés par une explosion sont sauvés par la transfusion de nombreuses poches de plasma. Venu à leur chevet, le maire apprend que ce plasma provient du sang recueilli auprès de donneurs du centre de Saint-Antoine. Il fait aussitôt appel à ses administrés pour aller donner leur sang là-bas, mais Tzanck propose plutôt de se rendre sur place, avec son équipe, et d'organiser une collecte de sang dans le local que le maire voudra bien mettre à sa disposition. Une salle de l'Hôtel-de-Ville est aussitôt aménagée selon ses instructions, où les volontaires se rendent en nombre, le mercredi 23 mars, pour une « Journée du Sang » annoncée dans toute la ville par des affiches. C'est, probablement, la première collecte « mobile » civile au monde — civile, car la guerre d'Espagne a quelque peu innové en ce domaine. Ce mode de collecte se généralise rapidement dans tous les pays. Tzanck avait eu l'intuition que l'acte du don serait grandement facilité si le donneur avait la possibilité de l'effectuer sur son lieu de résidence habituel. Dans la foulée, l'infatigable transfuseur organise tout un réseau de collectes mobiles, dont les acteurs disposent d'un matériel transportable adapté. Une fois encore, il a fait preuve de ses talents d'inventeur et d'organisateur.
La discipline transfusionnelle continue à évoluer. Aux États-Unis, un « plasma sec » a été mis au point et, en 1946, Edwin Cohn, un chimiste de l'Université de Harvard, a décrit un procédé industriel de fractionnement du plasma en ses différents composants. La Transfusion française doit parvenir, elle aussi, à élaborer de tels produits, et cela crée des besoins logistiques nouveaux. En 1949, avec le soutien d'Émile Aujaleu, directeur général de la Santé, Tzanck transfère son « Centre National de Transfusion Sanguine » de l'Hôpital Saint-Antoine en un local plus vaste, ancien garage de la rue Alexandre-Cabanel, dans le XVe arrondissement, précédemment utilisé comme usine militaire de pénicilline. Il réalise là le projet qu'il porte depuis longtemps et dont, deux années durant, il a surveillé personnellement les travaux : créer un centre national capable de recruter des donneurs dans un rayon étendu, de faire subir au sang collecté toutes les transformations nécessaires, de conserver sur place des stocks importants et de livrer les produits sanguins dans des voitures frigorifiques en un temps record. En un mot, un grand centre, à la mesure des besoins d'après-guerre en sang et en dérivés sanguins. Un amphithéâtre et une bibliothèque spécialisée, qui sera longtemps la plus grande du monde, vont y former les médecins transfuseurs et les futurs responsables de centres de transfusion. De plus, en même temps que cette usine de production de produits dérivés du sang, le bâtiment héberge, sur tout un étage, des laboratoires de recherche hautement spécialisés et pourvus d'un équipement de la plus grande modernité, qu'animent de jeunes chercheurs, tels que Jean-Pierre Soulier (1915-2003), qui succèdera à Tzanck à la tête de ce Centre national, ou Jean Dausset (1916-2009), que ses recherches conduiront à la découverte du système HLA, ce qui ouvrira la voie à la greffe d'organes et vaudra un prix Nobel à son inventeur en 1980.
Fondateur de la Société française de Transfusion sanguine, Tzanck préside le congrès mondial de cette discipline, qui se tient à Paris en 1937. On le voit aussi président de la Société parisienne de dermatologie de 1949 à 1951, car il n'a jamais rompu avec sa première spécialité. Tout au long de sa carrière, il aura publié de nombreux articles scientifiques (près de cinq cents), dans des domaines dont la diversité peut donner une impression de dispersion, liée à son ampleur et à sa richesse : les maladies infectieuses, la dermatologie, la coagulation, la cytologie hématologique et dermatologique, l'anaphylaxie et ses manifestations, les intolérances médicamenteuses et, bien sûr, la transfusion. Dans les années 30, il signe, seul ou en collaboration, plusieurs livres, dont certains deviennent des ouvrages de référence : Immunité, intolérance, biophylaxie, doctrine biologique et médecine expérimentale (1932) ; Problèmes théoriques et pratiques de la Transfusion sanguine (1933) ; Hématologie du praticien, en collaboration avec son neveu André Dreyfuss, disparu pendant la guerre (1938) ; Quelques Vérités premières, ou soi-disant telles, sur la transfusion sanguine, en collaboration avec Marcel Bessis (1945) ; Réanimation et transfusion sanguine, avec Paul Chiche (1945) ; Les Syndromes hémorragiques, avec Jean-Pierre Soulier (1949) ; Les Dermatoses allergiques. La pathologie cutanée réactionnelle, avec Edwin Sidi (1950). En 1947, mettant à profit l'expérience acquise en hématologie sur les études de prélèvements cellulaires obtenus par ponction de moelle ou de ganglion, il aura l'idée de développer une approche semblable dans les tumeurs cutanées et les « dermatoses bulleuses », et mettra au point, avec deux confrères, un test qui portera son nom : un trait d'union entre les deux branches de la médecine qu'il aura affectionné le plus. Cet examen simple et peu coûteux permet un diagnostic des plus rapides en observant simplement les cellules recueillies au microscope.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Tzanck, qui a perdu sa femme, malade depuis plusieurs mois, durant l'Occupation, renoue avec Marie Laurencin. Pour les convenances, l'artiste lui fait aménager une chambre dans le petit pavillon mis à sa disposition par le comte de Beaumont, attenant à son hôtel particulier de la rue Masseran. Tous deux ont largement passé la soixantaine et passent ensemble les fins de semaine. De cette liaison à éclipses avec Marie Laurencin, les descendants de Tzanck ont longtemps conservé divers tableaux et dessins, certains de 1912, d'autres de la période 1948-1949, comme la Jeune fille à la couronne ou ce Deux jeunes femmes, aujourd'hui exposé dans un musée de New York. Marie Laurencin survivra deux années à son amour de jeunesse et des dernières années.
Arnault Tzanck décède à Paris, le 8 février 1954, emporté par une grave infection intestinale. Il est enterré au cimetière Montparnasse.
Avant leur propre disparition, nous avions interrogé sur Tzanck ses élèves Jean-Pierre Soulier et Jean Dausset, qui, à un demi-siècle de distance, ne firent aucune difficulté pour évoquer leur maître et sa personnalité passionnée, indépendante et non-conformiste, mélange subtil d'influences slaves et latines : un être remuant et tout bruissant d'enthousiasme, au rire facile et sonore, mais capable de courtes colères. Son humour, assez personnel, s'exprimait sous forme d'anecdotes piquantes et d'aphorismes jetés à l'emporte-pièce : « La bêtise a elle-même ses héros » — « Ce sont surtout ses qualités qu'il faut savoir se faire pardonner » — « Être petit ne m'empêche pas de voir grand, être laid ne m'empêche pas de voir beau » — « Pourquoi croire quand on peut savoir ? »
À l'hôpital, Tzanck intervenait dans les réunions de service avec la voix forte, distincte et assurée d'un homme convaincu de la justesse et de l'importance de ce qu'il avançait, avec même une certaine véhémence lorsque la contradiction pointait son nez. Au physique, il était un personnage corpulent et de petite taille, à la silhouette trapue et râblée, aux allures non dépourvues de lourdeur et de gaucherie (il lui arriva, en passant un concours hospitalier, de ponctuer son exposé en balayant l'encrier d'un revers de main et en éclaboussant d'encre le jury). Bon violoniste, amateur de peinture et de littérature, Tzanck avait aussi un côté bon vivant, connaisseur en vins, en pâtisseries et en fromages.
Il avait surtout une trempe et une foi qui ne sont pas celles de tous les hommes. La transfusion française des années 1920-1950 lui doit à peu près tout. Il en a été le créateur, l'organisateur, l'animateur, le propagandiste et même davantage, car ce visionnaire avait déjà mis en place un principe sécuritaire qui, bien des décennies plus tard, sera baptisé « hémovigilance » par ceux-là même qui s'en croiront les initiateurs : « Grâce à un système de fiches, les résultats obtenus comme les réactions observées, sont centralisées de manière à permettre, — avec l'établissement de statistiques — des observations critiques et scientifiques. Ainsi se trouve réalisé un centre d'étude, susceptible d'aider au perfectionnement de la transfusion sanguine elle-même. »
On se prend à regretter que de tels hommes n'aient pas été aux commandes de la Transfusion française aux heures difficiles que l'on sait.
Auteur : Jean-Jacques LEFRERE
Le Fondateur de la transfusion française
Par Jean-Jacques LEFRERE
Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL
DE LA TRANSFUDION SANGUINE (INTS)
Bien qu'il soit inscrit sur quelques plaques commémoratives et sur celle d'une place du XVIIe arrondissement de Paris, le nom d'Arnault Tzanck, à la consonance difficile, est aujourd'hui à peu près inconnu du grand public. Celui qui le portait a cependant été le pionnier, en France, d'une grande cause médicale et humanitaire : la transfusion sanguine.
Né le 18 avril 1886 à Vladikavkaz — Vladicause dans sa forme francisée —, capitale de l'Ossétie du Nord, Arnault Tzanck appartient à une famille juive fortunée. Peu après sa venue au monde, s'amplifie la persécution des Juifs de cette région, qui se voient interdits de posséder des terres. Le père de Tzanck liquide en hâte les siennes, pourtant récemment acquises, vend tous ses biens et, pour fuir la vague de pogroms qu'il pressent prochaine, décide de quitter à jamais le Caucase. La famille, qui comprend cinq enfants — Arnault est le cadet —, s'embarque en 1887 à Batoum à destination de la France. Transplantation réussie : les parents ouvrent une fabrique de kéfir, boisson gazeuse du Caucase issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. Sans connaître le triomphe du chocolat, du café ou du coca-cola en d'autres temps, l'entreprise réussit et redonne la prospérité à la famille. Le produit se vend bien : même les hôpitaux parisiens se fournissent en kéfir.
Le jeune Arnault fait ses études secondaires à Paris, au lycée Montaigne, puis s'inscrit en Faculté de médecine. Il est nommé externe en 1904. De 1910 à 1914, il est interne à l'Hôpital Saint-Louis, où il se spécialise en dermatologie, spécialité alors peu courue, la plupart des maladies de peau étant considérées à l'époque comme d'origine infectieuse, et les dermatologues comme de simples observateurs de l'écorce et de l'apparence. Même si, par la suite, son attention va s'en détourner en partie au profit de la transfusion, Tzanck poursuivra sa carrière en dermatologie, mais surtout comme chercheur.
Au cours de ces années d'avant-guerre qui le voient interne à Saint-Louis, Tzanck se plaît à fréquenter un milieu d'artistes, de musiciens et d'écrivains, dont certains sont des déracinés comme lui. Il fait notamment la connaissance de Guillaume Apollinaire et d'Henri-Pierre Roché, l'auteur de Jules et Jim. Il appartient au cercle d'amis qui gravite autour de Marie Laurencin, avec laquelle le jeune Tzanck a une brève liaison, après la rupture avec le poète d'Alcools. Le médecin et l'artiste se perdront de vue pendant des années, avant de renouer après la Deuxième Guerre mondiale. Daniel Tzanck, le frère aîné (1874-1964), est dentiste et fréquente encore davantage les représentants de l'avant-garde, qui sont à la fois ses amis et ses patients. Comme il collectionne tableaux et livres, il leur laisse la possibilité de régler ses honoraires en nature, sous forme d'œuvres d'art ou de beaux ouvrages (Marcel Duchamp lui remet ainsi un trompe-l'œil intitulé Chèque Tzanck, qui fera entrer plus tard le nom du bénéficiaire dans l'Histoire de l'Art).
La Première Guerre mondiale éclate alors qu'Arnault Tzanck passe sa thèse de médecine. En 1915, marié et récemment père d'un fils, il est envoyé au Front, comme la plupart des internes des hôpitaux, et affecté à l'ambulance chirurgicale que dirige le chirurgien Antonin Gosset. Cette expérience, outre qu'elle va lui permettre d'obtenir la nationalité française — accordée à tout étranger se battant pour la France —, va changer radicalement ses projets de futur démobilisé. Les scènes auxquelles il assiste dans les salles d'opération proches des lieux de combat vont le marquer durablement : comment pouvait-il en être autrement pour cette génération de médecins confrontée aux massacres de la Grande Guerre ? Le Journal que Tzanck tient pendant le conflit narre la vie quotidienne d'un praticien recevant chaque jour les soldats tombés lors des attaques : « Ça a été du carnage. Dans les yeux des blessés, on retrouve pour ainsi dire empreintes les heures d'épouvante qu'ils ont vécues là-bas » (2 octobre 1915).
Dans le sentiment général d'impuissance face au déluge de chocs hémorragiques mortels, Tzanck prend conscience de la désastreuse indisponibilité des transfusions de ce sang qui pourrait sauver tant de combattants. Car, face à ce problème, médecins et chirurgiens sont désarmés : les hommes qu'on leur amène sans cesse sont souvent saignés à blanc, et certains ne parviennent même pas à l'ambulance ou à l'hôpital : exsangues et froids, exposés pendant des heures aux intempéries, ils ont déjà succombé à l'hémorragie. Ni l'organisation ni le savoir-faire de la transfusion n'existent au début du conflit, et le monde médical observe même, à l'égard de cette pratique, une réserve pleine de prudence.
Cependant, avec les premiers engagements, apparaît la nécessité pressante de redonner du sang à ceux qui le versent pour leur patrie. Le 16 octobre 1914, à l'Hôpital de Biarritz, a lieu la toute première transfusion sanguine de la guerre : Isidore Colas, un Breton en convalescence à la suite d'une blessure à la jambe, sauve, par le don de son sang, Henri Legrain, caporal au 45ème d'Infanterie, apporté du Front en état de choc hémorragique. La détermination du groupe ABO n'est pas encore entrée dans la pratique, loin de là, mais leurs sangs doivent être compatibles, car l'intervention réussit. À la fin de la même année, quarante-quatre transfusions sont ainsi pratiquées en France, toujours dans la méconnaissance complète du danger lié aux différences de groupes sanguins. Les donneurs sont des éclopés guéris ou des membres du personnel infirmier des hôpitaux de campagne.
Au cours des années suivantes, et jusqu'à la fin des hostilités, la transfusion de sang aux grands blessés se développe dans les ambulances militaires, tout en demeurant timidement, parcimonieusement, appliquée. Les donneurs sont, selon les cas, des camarades de combat, des parents venus en hâte, des infirmiers. Le corps médical est frappé par ces retours à la vie générés par la transfusion chez ces grands blessés paraissant condamnés, autant de sauvetages qui semblent tenir du miracle. Pourtant, réaliser un acte transfusionnel n'est pas aisé, surtout dans une ambulance militaire débordant de soldats meurtris et d'agonisants. C'est que l'on ne dispose pas encore de méthode pour empêcher le sang de coaguler, lorsqu'on le recueille chez les donneurs : il faut transfuser de « bras à bras », selon une méthode mise au point par George Crile, un chirurgien de Cleveland. Pour cette transfusion « directe », l'artère radiale du donneur est reliée chirurgicalement à une veine du receveur, allongé à son côté, soit par une canule, soit par une suture qui entraîne, pour le donneur, la perte définitive de son artère. Les premières transfusions sont ainsi entièrement dépendantes d'un acte chirurgical. Heureusement, début 1917, Emmanuel Hédon (1863-1933), professeur de physiologie de la Faculté de Montpellier, entreprend, dans les vieux bâtiments de la clinique Saint-Charles, d'étudier l'effet du citrate de soude pour prévenir artificiellement la coagulation du sang prélevé chez un sujet. En mai de la même année, Émile Jeanbrau (1873-1950), professeur de chirurgie urologique dans la même ville, mobilisé sur le Front mais ayant suivi les travaux de son collègue Hédon, pratique, sur des blessés de l'Ambulance n° 13, les trois premières transfusions faites avec un sang ainsi anticoagulé, que l'on va désormais appeler le « sang conservé » ou « sang stabilisé ». La pratique transfusionnelle s'en trouve immédiatement facilitée : de « directe », la transfusion peut devenir « indirecte », sans continuité entre les vaisseaux du donneur et du receveur, sans même que le premier soit présent au moment où l'on transfuse le second.
Ainsi, même si la technique de transfusion directe artério-veineuse est apparue trop complexe et trop délicate à réaliser dans des ambulances militaires sans cesse envahies de blessés graves, et dans des conditions de travail souvent épouvantables — elle ne pouvait guère s'effectuer qu'en arrière du champ de bataille, dans une structure sanitaire adaptée —, la Première Guerre mondiale aura été, en fin de compte, un puissant aiguillon du développement de la transfusion, en même temps qu'un immense et dramatique terrain d'expérimentations. La science — les découvertes récentes du groupe sanguin ABO et des effets du citrate — et la pratique se sont rejointes à la fin des hostilités, pour jeter les bases de la transfusion moderne. Tzanck admettra par la suite que jamais une période de paix n'aurait poussé de la sorte les médecins à l'acte. Pendant son travail à l'ambulance de Gosset, il a eu vent des résultats de Jeanbrau, qui l'ont vivement intéressé, quoiqu'il se montrera longtemps plus favorable au sang transfusé pur qu'au sang anticoagulé par du citrate.
Démobilisé — et décoré de la Croix de guerre —, Tzanck rejoint l'Hôpital Saint-Louis pour y poursuivre sa formation en dermatologie, mais il compte désormais consacrer une partie de son temps à la transfusion et à sa discipline-sœur, l'hématologie. Car la demande est devenue réelle : revenus du Front, les chirurgiens entendent bien continuer à appliquer les techniques transfusionnelles mises au point à proximité des tranchées. Ils ont compris que seule la transfusion peut sauver des malades risquant de succomber à une forte hémorragie, quelle qu'en soit la cause. Clairement, la transfusion est désormais considérée comme l'acte thérapeutique essentiel pour lutter contre le choc lié à une perte de sang gravissime. Curieusement, ce n'était pas réellement le cas auparavant. Tzanck a une autre raison, plus personnelle, de contribuer au développement de la transfusion : il a perdu une sœur des suites d'une hémorragie obstétricale et une transfusion aurait pu la sauver.
Certes, Tzanck continuera, toute sa vie, à s'intéresser à la dermatologie, sa première spécialité, mais sa mobilisation, en 1915, a donné une seconde orientation à sa carrière professionnelle, et les horreurs de la Première Guerre mondiale vont transformer le dermatologue un tantinet mondain en apôtre de la transfusion. En 1923, il a déjà organisé, dans un bâtiment de l'Hôpital Saint-Antoine, à Paris, un véritable « centre de transfusion », qui est le premier au monde à voir le jour. Les conditions de travail y sont toutefois des plus modestes : l'administration de l'hôpital a mis à sa disposition une petite pièce, cloisonnée de planches et aménagée dans la salle des admissions. Ce réduit de deux mètres et demi sur trois a, pour tout ameublement, une table, une chaise et un téléphone.
Tel est l'ancêtre de tous les établissements de transfusion d'aujourd'hui. La secrétaire qui en assure la permanence dispose d'un fichier des donneurs que l'on peut contacter. Car Tzanck estime que, pour être pleinement efficace, la transfusion doit disposer à tout moment de donneurs de sang. Dans les premiers temps, il s'est adressé aux familles et aux proches des malades et des blessés de l'hôpital — une pratique encore généralisée aujourd'hui dans nombre de pays en voie de développement. Puis, avec son entrain naturel, sa chaleur et sa force de conviction, il est parvenu à recruter des volontaires, non seulement parmi le personnel médical — infirmières et étudiants —, mais aussi dans différents corps de métier. Ayant obtenu l'autorisation du préfet de police de Paris, il prononce régulièrement des conférences devant les gardiens de la paix pour les convaincre de devenir donneurs : un contingent nombreux est ainsi constitué, et qui ira s'amplifiant. À leur tour, les sapeurs-pompiers parisiens sont sollicités pour venir offrir leur sang au poste d'urgence de Saint-Antoine : ils ont l'avantage d'être toujours joignables et prêts à répondre à l'appel, ce qui n'est pas toujours le cas des autres donneurs. Parfois, les médecins de garde retroussent eux-mêmes la manche pour donner leur propre sang. Tzanck, de son côté, donnera plus de deux cents fois au cours de sa vie, même après l'âge limite, qu'il a lui-même, dès le début, fixé à 60 ans.
Dans les premiers temps, la Direction de l'Assistance publique a considéré l'aventure avec un scepticisme à peine dissimulé, d'autant que le local de Saint-Antoine ne ressemble guère à un centre médical classique. On y croise d'élégantes visiteuses à chapeau, grandes dames de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie ayant répondu à l'appel de Tzanck et apportant une main d'œuvre bénévole et surtout un soutien financier, car il faut rétribuer les donneurs : un franc par centimètre cube est le tarif habituel. Par la suite, l'Assistance publique de Paris prendra en charge une partie, puis la totalité de ces indemnités versées pour les transfusions réalisées dans ses hôpitaux.
Les résultats obtenus par cette petite organisation se révèlent immédiatement spectaculaires : dès l'année 1924, le nombre d'accouchées mortes d'hémorragie à la maternité de Saint-Antoine diminue de manière radicale. À vrai dire, on n'en observe plus aucune.
En 1928, Tzanck, qui va bientôt être nommé « médecin des Hôpitaux de Paris » — il était temps : il a 42 ans — fonde une association qu'il baptise Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence. Gosset, son supérieur de l'ambulance militaire, et l'obstétricien de la Maternité de Saint-Antoine, Edmond Levy-Solal, l'ont aidé activement dans cette entreprise. Louis Mourier, directeur général de l'Assistance publique de Paris, fait également partie du comité. De grandes dames de l'aristocratie — la duchesse d'Uzès (présidente du comité d'honneur), la marquise de Crussol, la vicomtesse de Fontenay, la baronne Robert de Rothschild — ont apporté leurs deniers et la puissance de leurs relations. La structure va par la suite bénéficier grandement du dynamisme de ces dames, qui rivalisent d'imagination et d'initiatives pour collecter les fonds nécessaires lors de galas et de tombolas.
Le but de cette Œuvre est de répondre à la sollicitation des prescripteurs hospitaliers de transfusions. Car, de plus en plus, le poste de Saint-Antoine, qui tient lieu à la fois de permanence, de secrétariat et de laboratoire, se trouve sollicité pour les urgences transfusionnelles de tous les hôpitaux de Paris. Une des actions prioritaires est donc de constituer un réseau de donneurs mobilisables à chaque urgence, par des « astreintes à domicile » à jour fixe. Tous sont des « donneurs universels », appartenant au groupe O. La grande innovation de la transfusion devenue civile a été en effet de prendre en compte la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Quelques années plus tard, Tzanck évoquera dans un livre l'historique de cette Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence et ses premières conditions de fonctionnement : « Cette organisation ne pouvait s'inspirer des réalisations étrangères : en Europe, rien de comparable n'avait été fait ; en Amérique, les organisations comparables étaient à peine ébauchées ; et en tout cas ne visaient pas particulièrement la clientèle hospitalière. Au surplus, ces organisations étaient alors inconnues en France. Il fallait trouver une formule particulière qui permit d'indemniser les donneurs de leurs frais de déplacement, de leur temps perdu, et même de la fatigue causée, mais sans prétendre donner le « prix du sang ». On conservait ainsi au geste du donneur son caractère généreux. »
L'activité du centre de Saint-Antoine s'accroît dès lors de manière vertigineuse : plus de deux cents transfusions réalisées en 1929, près de huit cents l'année suivante, deux mille en 1931, près de quatre mille en 1932, huit mille l'année d'après. Ce chiffre passe à trente-cinq mille dans l'ensemble des hôpitaux parisiens pour la période 1933-1939. L'Œuvre de la Transfusion sanguine d'urgence est reconnue d'utilité publique le 14 janvier 1931, par un décret signé Gaston Doumergue.
Ces premières années ont leur côté héroïque : un petit groupe de médecins « qualifiés » a accepté d'être contacté par téléphone et de se rendre en urgence sur l'hôpital d'où a été lancé l'appel. Pendant ce temps, la secrétaire appelle un des donneurs du fichier : une voiture va le chercher à domicile pour le conduire en présence du malade, dans un hôpital ou en ville. Parfois, le malade a eu malheureusement le temps de mourir avant l'arrivée de l'équipe de transfusion. Ceci, bien sûr, au cours des premiers temps de fonctionnement, pendant lesquels Tzanck pratique encore la transfusion de bras à bras. Il ne fait plus appel à un chirurgien, mais transfuse ses patients avec un appareil de sa conception et de sa fabrication ¬¬— l'homme a de l'habileté manuelle et se plaît à dessiner des plans d'instruments de son invention. Son appareillage consiste en une seringue montée sur un distributeur à trois voies, avec des pompes manœuvrées par un robinet, mais assez difficiles à manier : il suffit d'un peu de lenteur dans l'opération pour que le sang prélevé coagule. Cependant, ce système ne fait pas courir le risque, comme un autre appareil concurrent contemporain, de passage du sang du receveur dans le système vasculaire du donneur (le contraire de l'effet voulu !). De plus, un ballon permet de mesurer, quoique approximativement, le volume de sang transfusé, et ceci est une innovation totale. Tzanck fait régulièrement la démonstration de son appareil aux apprentis transfuseurs : il ponctionne la veine du receveur, se fait piquer sa propre veine par un des assistants, monte l'appareil et exécute l'opération avec son unique main libre.
Tzanck pressent tellement les complexités de la thérapeutique qu'il est en train de faire germer qu'il impose des précautions demeurant de mise aujourd'hui dans la sélection des candidats au don de sang : les sujets qui se présentent doivent remplir une déclaration sur l'honneur portant sur leur état de santé et sont examinés dans un local dépendant de la consultation de médecine de Saint-Antoine. Tzanck écarte en outre les sujets tuberculeux et impaludés. Ce n'est pas tout : une prise de sang, en vue du dépistage de la syphilis, est systématiquement envoyée dans le service de l'Hôpital Broca où Tzanck a été nommé, en 1932, responsable de la consultation de dermatologie (il ne rejoindra Saint-Louis, l'hôpital de sa formation, qu'en 1937, pour y prendre la tête d'un des six services de dermatologie de cet hôpital).
Le règlement, établi par Tzanck lui-même, pour être donneur en France dans les années 1930, apparaît aujourd'hui comme une sorte de charte pionnière du don de sang. Même si certains éléments en sont devenus obsolètes avec les années, les conditions physiques et morales préconisées restent de mise :
« Pour être donneur de sang, il faut :
- Être bien portant.
- Pouvoir être atteint par téléphone.
- Soit pouvoir se rendre une fois par mois à un appel de transfusion d'urgence, soit accepter de prendre la garde une fois par mois à la Permanence de l'Œuvre, à l'Hôpital Saint-Antoine, le matin de 9 h. à 13 h. ou l'après-midi de 13 h. à 19 h.
- S'engager à se rendre à tout appel dans le moindre délai. […]
Le fait de donner son sang constitue avant tout un acte de dévouement. Pour qu'il soit complet, le Donneur doit :
- Être sobre et de santé parfaite ; s'il s'aperçoit sur lui-même de la moindre lésion, c'est un devoir moral pour lui de mettre au courant immédiatement les médecins attachés à la Transfusion Sanguine d'Urgence. […]
- En raison de l'impressionnabilité des malades, l'apparence personnelle du Donneur est très importante. Il doit donc être propre sur sa personne et correct dans sa tenue, quand il répond à un appel. »
Qui douterait encore de la nécessité d'une organisation bien structurée pour la transfusion d'urgence ? Un événement national va convaincre les derniers sceptiques. Le 6 mai 1932, Paul Doumer, président de la République, vient d'arriver à la Fondation Salomon de Rothschild, rue Berryer, près de la place de l'Étoile, où se tient la vente de bienfaisance annuelle en faveur des écrivains anciens combattants et en mémoire de ceux tués à la guerre. Doumer se trouve devant le stand de Claude Farrère, président de l'association organisatrice (et prix Goncourt 1905 pour Les Civilisés), lorsqu'un émigré russe du nom de Paul Gorguloff — un docteur en médecine ! — tire dans sa direction trois coups de revolver qui le blessent grièvement, à la tête et sous le bras. Le corpulent Farrère, qui tente de s'interposer, est lui-même atteint de deux balles dans le bras. Le Président est évacué vers l'hôpital Beaujon. L'artère humérale tranchée, il perd beaucoup de sang : il lui faut une transfusion de toute urgence. Tzanck, qui est pratiquement le seul spécialiste de transfusion dans le Paris de l'époque, est appelé en catastrophe. Se faisant accompagner par sa domestique, laquelle, par son groupe ABO, est donneuse universelle, il se précipite dans sa voiture, garée au pied de son domicile de la rue Goujon. Au passage, il embarque un agent qui saute sur le marchepied et, se cramponnant à la portière, ouvre la circulation à coups de sifflet. Le médecin arrive trop tard : malgré plusieurs transfusions, le Chef de l'État meurt au cours de la nuit. Le hasard, qui a ses cruautés, a voulu que l'Union des soins à domicile Arnault Tzanck de Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, ait pour adresse l'avenue... Paul-Doumer.
Autre intervention spectaculaire : le soir du 23 décembre 1933, un monstrueux accident de chemin de fer survient à Lagny-Pomponne : le rapide Paris-Strasbourg percute par l'arrière l'express Paris-Nancy. L'accident, qui fait deux cents morts et des centaines de blessés, devient la seconde catastrophe ferroviaire la plus meurtrière en France. Les transfuseurs du Centre d'urgence de Saint-Antoine accourent sur les lieux, et le sang des donneurs mobilisés sauve quelques vies.
Les besoins en sang continuent à aller croissant, à une époque où les actes chirurgicaux se développent considérablement. Or le don de sang ne correspond pas encore à une démarche spontanée : il n'est que la réponse à une sollicitation, avec, de surcroît, une rétribution à la clé. Tzanck, pourtant, a toujours prôné le bénévolat et, avec les années, seuls toucheront une indemnité les « donneurs de garde », qui doivent répondre à tout appel urgent lancé, de jour comme de nuit, par les hôpitaux parisiens.
Dans plusieurs pays, diverses pistes sont explorées par des pionniers de la transfusion. La plus déroutante est celle pratiquée, au début des années 30, par le Russe Serge Judine. Ce médecin (dont la ressemblance avec Louis Jouvet tient du prodige) dirige, dans l'Institut Silfassyvski de Moscou, un service de chirurgie d'urgence dont les besoins transfusionnels sont très importants. Depuis quelque temps, il fait appel à des donneurs bénévoles — mais non volontaires — en prélevant du sang de cadavre : à coups de massages cardiaques, il saigne les individus tués par accident ou morts subitement. L'efficacité de ces transfusions se révèle comparable à celle du sang de donneur vivant, mais, comme la loi russe, correspondant au décret français du 15 mars 1928, empêche de toucher à un cadavre dans les vingt-quatre heures qui suivent le décès, Judine agit clandestinement. La pratique finit toutefois par s'éventer et, après une polémique ardue, est officiellement interdite. Le Congrès international de transfusion qui se tient à Paris en 1937 condamne aussi le procédé, repoussant même tout projet de prélever du sang de cadavre frais, fût-ce à visée d'étude.
Renonçant peu à peu à la transfusion de bras à bras, Tzanck finit par admettre les avantages du « sang conservé ». Ce sang, stabilisé pour quelques jours, peut être transporté pour une utilisation à distance et différée dans le temps. Il peut en outre être, avant son emploi, l'objet de contrôles biologiques et être injecté au rythme désiré, par des perfusions lentes ou au contraire rapides, et en quantité connue, ce qui n'était pas le cas du sang passé de bras à bras, pour lequel on arrêtait souvent la transfusion lorsque le donneur devenait plus pâle que le receveur ! Une première « banque de sang » s'est ouverte à Chicago en 1937 : on y conserve, à basse température, du sang citraté conservable pendant deux semaines. Tzanck adopte définitivement cette pratique l'année suivante — la transfusion militaire fait de même — et s'équipe en bouteilles de verre et en citrate.
Ces techniques de conservation du sang connaissent d'ailleurs un regain d'intérêt en vue de l'éventualité d'une nouvelle guerre. La possibilité de constituer des stocks a vu sa première utilisation massive en 1936, au centre de Barcelone, pour la prise en charge des blessés de la guerre civile : une rivière de près de 9000 litres de sang a été transfusée pendant la durée de ce conflit, qui en a d'ailleurs fait couler un véritable fleuve. Parmi les médecins français ayant apporté leur soutien aux combattants républicains espagnols, a figuré le nom d'Arnault Tzanck, membre du comité de la Centrale sanitaire d'aide à l'Espagne républicaine : de nombreux dons de sang prélevés et préparés à Saint-Antoine ont été expédiés pour soutenir la « Cause ».
Deux ans plus tard, devant la perspective d'un nouveau conflit mondial, la pratique de conservation du sang à basse température, dans des ampoules citratées, va s'amplifiant. Des mallettes isothermes sont mises au point pour le transport sur le terrain des combats par des formations sanitaires. Tzanck propose au ministère de la Guerre que les groupes sanguins des appelés soient établis de manière systématique et inscrits sur leur plaque d'identité. Une suggestion aussi simple que pleine de bon sens, mais qui suscite une polémique… laquelle ne sera pas épuisée lorsque la Seconde Guerre mondiale sera déclarée.
Tzanck n'a jamais manqué de charisme. Sans cet atout, il ne serait sans doute pas parvenu à doter sa patrie d'adoption d'une organisation transfusionnelle qui va servir de modèle à de nombreux pays. Il a été aussi un propagandiste très efficace. En marge de son activité médicale proprement dite, il prononce des conférences dans les salles populaires ou dans les salons du Faubourg Saint-Germain : dans les premières, pour recruter des donneurs, car il sait aussi transfuser l'altruisme ; dans les seconds, pour en appeler à la générosité de quelques mécènes. Avec les fonds recueillis, il peut ainsi faire construire en 1937, dans l'enceinte de l'Hôpital Saint-Antoine, un bâtiment suffisamment spacieux pour les besoins de développement de son centre. En réalité, le financement a été principalement assuré par Mme Raba Deutsch de la Meurthe, membre d'une famille à la fortune immense, connue pour son action caritative dans les domaines de la technologie et de la philanthropie. L'Assistance publique a donné son accord et fourni le terrain.
Tzanck devient tout naturellement le directeur de ce Centre de Transfusion sanguine et de recherches hématologiques. Pendant les premiers mois d'activité, les locaux en sont jugés beaucoup trop vastes par ceux-là mêmes qui y travaillent, mais leur point de vue changera du tout au tout en 1939, au début des hostilités, lorsqu'il faudra même compléter les installations par des cantonnements construits par le Génie : des laboratoires et des services de collectes de sang supplémentaires seront aménagés en hâte dans des baraques de bois au toit goudronné. Pour l'heure, le bâtiment tout neuf — et encore debout aujourd'hui, quoiqu'un peu décati — est inauguré en juin 1938 par Marc Rucart, ministre de la Santé. La presse se fait l'écho de l'événement, non sans le placer dans la perspective d'un conflit franco-allemand dont l'échéance paraît inévitable et proche : « Le pavillon, rationnellement construit et aménagé d'une façon des plus modernes, comprend des laboratoires destinés aux examens et recherches hématologiques et abrite les services de l'œuvre de la transfusion sanguine urgente qui assure chaque année, en étroite collaboration avec l'administration de l'Assistance publique plus de 5000 transfusions dans les hôpitaux parisiens. […] Les nouveaux locaux composent une innovation : une chambre froide pour le stockage en ampoules du sang humain prélevé sur des donneurs bénévoles qui pourra être utilisé pendant une période de trois semaines. […] Rappelons qu'un deuxième centre, établi à plusieurs mètres sous terre, sera créé à quelques kilomètres de Paris. »
La dernière phrase ne relève pas entièrement des fantasmes qu'engendre toute guerre. Mobilisé en septembre 1939 dans sa spécialité, avec le grade de lieutenant-colonel, Tzanck se voit chargé d'organiser à Blois un centre de transfusion destiné à prendre le relais, si nécessaire, du centre de Paris. Il devient aussi un acteur de premier plan dans l'organisation de la transfusion militaire et, soutenu par le ministère de la Santé et le Service de Santé de l'Armée, il établit un réseau national avec tous les centres de province. Car, dans ces années d'immédiate avant-guerre, la structure mise en place par Tzanck à l'Hôpital Saint-Antoine a été reprise dans la plupart des grandes villes de province, et des centres régionaux de transfusion sont entrés en fonction.
En ces heures au ciel plombé, il importe en premier lieu de constituer des réserves en sang. Le 14 septembre 1939, Le Figaro publie un article intitulé Six cents personnes viennent chaque jour à l'Hôpital Saint-Antoine offrir leur sang pour la France : « Dès la guerre déclarée, le sang a afflué à ce petit pavillon en briques rouges, comme s'il eut été le cœur de la France. Hier, dans les trois heures où le Centre sanguin reçoit sa clientèle du dévouement, on a compté six cent dix donneurs. C'est à peu près la moyenne quotidienne. Beaucoup d'étrangers parmi ces volontaires : des Russes, des Tchèques. On y a même vu un Allemand. Il venait offrir une pinte de sang avant de gagner son camp de rassemblement. Beaucoup de donneurs se voient récusés. On n'accepte que des sujets parfaitement sains et seulement ceux qui ont un sang « universel », c'est-à-dire pouvant être infusé à tout le monde. » De même, soixante-deux ans plus tard, l'on verra affluer, dans les Centres de transfusion du monde entier, des foules traumatisées par le spectacle d'avions s'écrasant sur les Twin Towers de New York.
Après la Drôle de guerre, la défaite et l'armistice, Tzanck regagne son service de dermatologie de l'Hôpital Saint-Louis. Mais à partir de l'été de 1940, la presse antisémite, notamment le journal Le Pilori, s'en prend aux médecins juifs, appelant à leur boycottage et publiant leur nom et leur adresse. Tzanck, personnalité médicale très connue, fait l'objet d'une campagne particulièrement haineuse. Une première étape de l'exclusion des médecins juifs est la loi du 16 août 1940, interdisant l'exercice de leur métier aux praticiens étrangers, à ceux qui n'ont acquis la nationalité française qu'après 1927 et à ceux qui sont nés en France de père étranger. Une fois l'arrêté promulgué, les praticiens étrangers ont huit jours pour cesser leur activité, sous peine de s'exposer à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Le 3 octobre suivant, une nouvelle loi stipule qu'il est désormais interdit aux Juifs d'être professeur de Faculté, chef de clinique ou assistant. L'Assistance publique de Paris applique cette législation visant à l'« aryanisation ». Dans l'amertume que l'on conçoit, Tzanck, menacé d'arrestation, passe en zone libre avec les siens ; il séjourne à Lodève, dans le Languedoc, et à Marseille. Puis, pour échapper à l'arrestation et à la déportation, il passe clandestinement les Pyrénées, perdant au passage tous ses bagages et son passeport. En Espagne, sa notoriété joue en sa faveur : des médecins le cachent et lui procurent un visa pour se réfugier au Chili. Après avoir fui son pays natal dans l'enfance, le voilà contraint, pour les mêmes raisons, de fuir sa terre d'adoption.
Dans son exil chilien, l'homme d'action se souvient qu'il est aussi homme de réflexion et, pour occuper cet intolérable inactivité que lui impose l'occupation allemande de son pays, il compose un ouvrage, méditation philosophique et éthique sur la connaissance, sur les pièges de la raison, sur les problématiques de la biologie. Bien que l'influence de Bergson et de Claude Bernard y soient sensibles, l'auteur y fait montre d'un esprit libre de tout conformisme. Tzanck en achève la rédaction à Santiago-du-Chili en avril 1943. Sous le titre La Conscience créatrice. Entretiens sur la vie et la pensée, le texte est publié l'année suivante à Alger, chez Charlot, un libraire-éditeur qui vient de faire paraître les premiers livres d'un certain Albert Camus.
Car, courant 1944, Tzanck a rejoint Alger pour s'y s'associer à l'action engagée, dès le débarquement allié en Afrique du Nord, par son confrère Edmond Benhamou, de l'Hôpital Mustapha, lequel organise le ravitaillement en sang des Forces françaises évoluant dans la région, puis celui des organismes de réanimation du front de l'Ouest et de la première Armée Française en Alsace. Deux fortes personnalités, Benhamou et Tzanck, et des relations que ternissent quelques nuages.
Le développement de la transfusion illustre remarquablement l'influence des conflits internationaux sur le progrès scientifique en général, et médical en particulier. Durant la Première Guerre mondiale, l'hémorragie sur le champ de bataille a éperonné la pratique de la transfusion, qui s'est poursuivie, harmonisée et organisée après le conflit. Les progrès de la transfusion ont subi un brutal coup d'arrêt dès les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale et pendant l'Occupation, pour reprendre de plus belle, à partir de novembre 1942, lors du débarquement des troupes anglo-saxonnes en Afrique du Nord. La recherche en temps de paix n'en reste pas moins à prôner.
Dès la Libération de Paris, se met en place une organisation, à la fois civile et militaire, de la transfusion, placée, jusqu'en juin 1945, sous la direction de Tzanck — qui attendra cependant d'être versé dans la réserve pour lancer cette boutade : « J'ai souvent vu militariser des civils, j'ai rarement vu civiliser des militaires. » Puis, après avoir participé, en uniforme de colonel des Forces françaises libres, à l'accueil des survivants de la déportation à l'Hôtel Lutetia, Tzanck reprend, à l'Hôpital Saint-Louis, le service qu'il a été obligé de quitter pendant l'Occupation. Comme avant-guerre, il continue à mener de front sa double activité : dermatologue à Saint-Louis et transfuseur à Saint-Antoine.
Dans les années d'immédiate après-guerre, la transfusion française va cahin-caha. De grandes quantités de sang restent nécessaires, la réanimation et la chirurgie devenant de plus en plus exigeantes et consommatrices. C'est l'époque où les donneurs deviennent uniquement bénévoles et volontaires, prenant le relais de ces donneurs rémunérés que l'on appelait jadis en urgence. Ainsi naît, en 1949, la première Fédération nationale de donneurs bénévoles, dont Tzanck, qui en a été l'âme et le muscle, reçoit la présidence d'honneur. Il sera aussi l'un des inspirateurs de la loi du 21 juillet 1952, qui va réglementer les principes éthiques du don de sang, selon lesquels « le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce, comme issu du corps humain ».
Dès lors, dans toute la France, souvent à partir d'initiatives individuelles, apparaissent de nombreux centres de collecte du sang, où les donneurs sont conviés et accueillis régulièrement. La plupart du temps, cette collecte s'est structurée à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un hôpital. En mars 1949, un épisode, auquel Tzanck, décidément pionnier en tout ce qui touche à la transfusion, est encore associé, va profondément changer, ou plutôt élargir, les méthodes de collecte. Dans une petite usine de Vincennes, trois ouvriers gravement blessés par une explosion sont sauvés par la transfusion de nombreuses poches de plasma. Venu à leur chevet, le maire apprend que ce plasma provient du sang recueilli auprès de donneurs du centre de Saint-Antoine. Il fait aussitôt appel à ses administrés pour aller donner leur sang là-bas, mais Tzanck propose plutôt de se rendre sur place, avec son équipe, et d'organiser une collecte de sang dans le local que le maire voudra bien mettre à sa disposition. Une salle de l'Hôtel-de-Ville est aussitôt aménagée selon ses instructions, où les volontaires se rendent en nombre, le mercredi 23 mars, pour une « Journée du Sang » annoncée dans toute la ville par des affiches. C'est, probablement, la première collecte « mobile » civile au monde — civile, car la guerre d'Espagne a quelque peu innové en ce domaine. Ce mode de collecte se généralise rapidement dans tous les pays. Tzanck avait eu l'intuition que l'acte du don serait grandement facilité si le donneur avait la possibilité de l'effectuer sur son lieu de résidence habituel. Dans la foulée, l'infatigable transfuseur organise tout un réseau de collectes mobiles, dont les acteurs disposent d'un matériel transportable adapté. Une fois encore, il a fait preuve de ses talents d'inventeur et d'organisateur.
La discipline transfusionnelle continue à évoluer. Aux États-Unis, un « plasma sec » a été mis au point et, en 1946, Edwin Cohn, un chimiste de l'Université de Harvard, a décrit un procédé industriel de fractionnement du plasma en ses différents composants. La Transfusion française doit parvenir, elle aussi, à élaborer de tels produits, et cela crée des besoins logistiques nouveaux. En 1949, avec le soutien d'Émile Aujaleu, directeur général de la Santé, Tzanck transfère son « Centre National de Transfusion Sanguine » de l'Hôpital Saint-Antoine en un local plus vaste, ancien garage de la rue Alexandre-Cabanel, dans le XVe arrondissement, précédemment utilisé comme usine militaire de pénicilline. Il réalise là le projet qu'il porte depuis longtemps et dont, deux années durant, il a surveillé personnellement les travaux : créer un centre national capable de recruter des donneurs dans un rayon étendu, de faire subir au sang collecté toutes les transformations nécessaires, de conserver sur place des stocks importants et de livrer les produits sanguins dans des voitures frigorifiques en un temps record. En un mot, un grand centre, à la mesure des besoins d'après-guerre en sang et en dérivés sanguins. Un amphithéâtre et une bibliothèque spécialisée, qui sera longtemps la plus grande du monde, vont y former les médecins transfuseurs et les futurs responsables de centres de transfusion. De plus, en même temps que cette usine de production de produits dérivés du sang, le bâtiment héberge, sur tout un étage, des laboratoires de recherche hautement spécialisés et pourvus d'un équipement de la plus grande modernité, qu'animent de jeunes chercheurs, tels que Jean-Pierre Soulier (1915-2003), qui succèdera à Tzanck à la tête de ce Centre national, ou Jean Dausset (1916-2009), que ses recherches conduiront à la découverte du système HLA, ce qui ouvrira la voie à la greffe d'organes et vaudra un prix Nobel à son inventeur en 1980.
Fondateur de la Société française de Transfusion sanguine, Tzanck préside le congrès mondial de cette discipline, qui se tient à Paris en 1937. On le voit aussi président de la Société parisienne de dermatologie de 1949 à 1951, car il n'a jamais rompu avec sa première spécialité. Tout au long de sa carrière, il aura publié de nombreux articles scientifiques (près de cinq cents), dans des domaines dont la diversité peut donner une impression de dispersion, liée à son ampleur et à sa richesse : les maladies infectieuses, la dermatologie, la coagulation, la cytologie hématologique et dermatologique, l'anaphylaxie et ses manifestations, les intolérances médicamenteuses et, bien sûr, la transfusion. Dans les années 30, il signe, seul ou en collaboration, plusieurs livres, dont certains deviennent des ouvrages de référence : Immunité, intolérance, biophylaxie, doctrine biologique et médecine expérimentale (1932) ; Problèmes théoriques et pratiques de la Transfusion sanguine (1933) ; Hématologie du praticien, en collaboration avec son neveu André Dreyfuss, disparu pendant la guerre (1938) ; Quelques Vérités premières, ou soi-disant telles, sur la transfusion sanguine, en collaboration avec Marcel Bessis (1945) ; Réanimation et transfusion sanguine, avec Paul Chiche (1945) ; Les Syndromes hémorragiques, avec Jean-Pierre Soulier (1949) ; Les Dermatoses allergiques. La pathologie cutanée réactionnelle, avec Edwin Sidi (1950). En 1947, mettant à profit l'expérience acquise en hématologie sur les études de prélèvements cellulaires obtenus par ponction de moelle ou de ganglion, il aura l'idée de développer une approche semblable dans les tumeurs cutanées et les « dermatoses bulleuses », et mettra au point, avec deux confrères, un test qui portera son nom : un trait d'union entre les deux branches de la médecine qu'il aura affectionné le plus. Cet examen simple et peu coûteux permet un diagnostic des plus rapides en observant simplement les cellules recueillies au microscope.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Tzanck, qui a perdu sa femme, malade depuis plusieurs mois, durant l'Occupation, renoue avec Marie Laurencin. Pour les convenances, l'artiste lui fait aménager une chambre dans le petit pavillon mis à sa disposition par le comte de Beaumont, attenant à son hôtel particulier de la rue Masseran. Tous deux ont largement passé la soixantaine et passent ensemble les fins de semaine. De cette liaison à éclipses avec Marie Laurencin, les descendants de Tzanck ont longtemps conservé divers tableaux et dessins, certains de 1912, d'autres de la période 1948-1949, comme la Jeune fille à la couronne ou ce Deux jeunes femmes, aujourd'hui exposé dans un musée de New York. Marie Laurencin survivra deux années à son amour de jeunesse et des dernières années.
Arnault Tzanck décède à Paris, le 8 février 1954, emporté par une grave infection intestinale. Il est enterré au cimetière Montparnasse.
Avant leur propre disparition, nous avions interrogé sur Tzanck ses élèves Jean-Pierre Soulier et Jean Dausset, qui, à un demi-siècle de distance, ne firent aucune difficulté pour évoquer leur maître et sa personnalité passionnée, indépendante et non-conformiste, mélange subtil d'influences slaves et latines : un être remuant et tout bruissant d'enthousiasme, au rire facile et sonore, mais capable de courtes colères. Son humour, assez personnel, s'exprimait sous forme d'anecdotes piquantes et d'aphorismes jetés à l'emporte-pièce : « La bêtise a elle-même ses héros » — « Ce sont surtout ses qualités qu'il faut savoir se faire pardonner » — « Être petit ne m'empêche pas de voir grand, être laid ne m'empêche pas de voir beau » — « Pourquoi croire quand on peut savoir ? »
À l'hôpital, Tzanck intervenait dans les réunions de service avec la voix forte, distincte et assurée d'un homme convaincu de la justesse et de l'importance de ce qu'il avançait, avec même une certaine véhémence lorsque la contradiction pointait son nez. Au physique, il était un personnage corpulent et de petite taille, à la silhouette trapue et râblée, aux allures non dépourvues de lourdeur et de gaucherie (il lui arriva, en passant un concours hospitalier, de ponctuer son exposé en balayant l'encrier d'un revers de main et en éclaboussant d'encre le jury). Bon violoniste, amateur de peinture et de littérature, Tzanck avait aussi un côté bon vivant, connaisseur en vins, en pâtisseries et en fromages.
Il avait surtout une trempe et une foi qui ne sont pas celles de tous les hommes. La transfusion française des années 1920-1950 lui doit à peu près tout. Il en a été le créateur, l'organisateur, l'animateur, le propagandiste et même davantage, car ce visionnaire avait déjà mis en place un principe sécuritaire qui, bien des décennies plus tard, sera baptisé « hémovigilance » par ceux-là même qui s'en croiront les initiateurs : « Grâce à un système de fiches, les résultats obtenus comme les réactions observées, sont centralisées de manière à permettre, — avec l'établissement de statistiques — des observations critiques et scientifiques. Ainsi se trouve réalisé un centre d'étude, susceptible d'aider au perfectionnement de la transfusion sanguine elle-même. »
On se prend à regretter que de tels hommes n'aient pas été aux commandes de la Transfusion française aux heures difficiles que l'on sait.
Auteur : Jean-Jacques LEFRERE